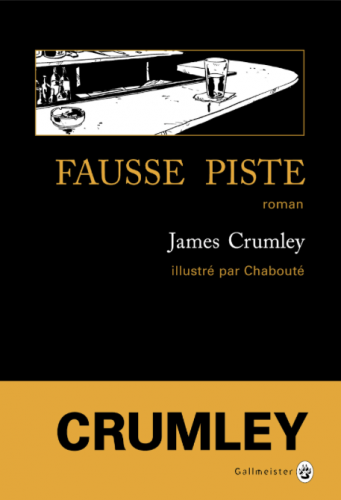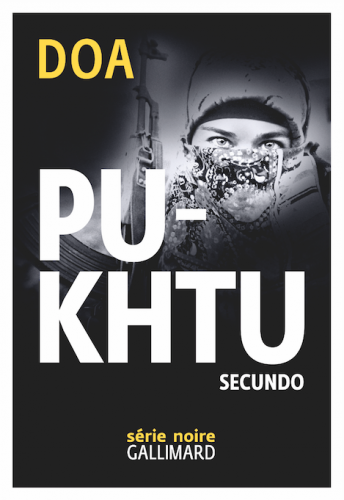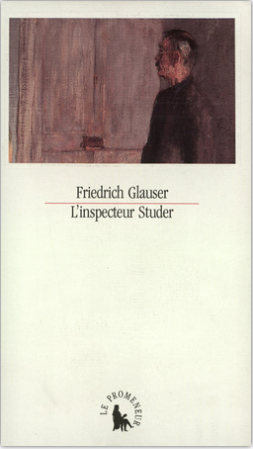Joe Meno : Le Blues De La Harpie. Solder sa dette.
 Lorsque deux anciens taulards, en quête de rédemption, entrent en scène, on peut être quasiment certain qu’une référence à Johnny Cash ne sera jamais bien loin à l’instar de Joe Meno qui lui rend hommage dans Le Blues De La Harpie une des dernières découvertes de la maison d’édition Agullo. Et puisqu’il s’agit d’une sombre histoire d’amour où la tragédie s’immisce au détour de chacune des rues de cette petite bourgade du Midwest il conviendra d’écouter I Walk On The Line, une des plus belles déclarations d’amour correspondant parfaitement à l’état d’esprit de ce récit poignant dans lequel on décèle quelques tonalités rappelant les romans de John Steinbeck.
Lorsque deux anciens taulards, en quête de rédemption, entrent en scène, on peut être quasiment certain qu’une référence à Johnny Cash ne sera jamais bien loin à l’instar de Joe Meno qui lui rend hommage dans Le Blues De La Harpie une des dernières découvertes de la maison d’édition Agullo. Et puisqu’il s’agit d’une sombre histoire d’amour où la tragédie s’immisce au détour de chacune des rues de cette petite bourgade du Midwest il conviendra d’écouter I Walk On The Line, une des plus belles déclarations d’amour correspondant parfaitement à l’état d’esprit de ce récit poignant dans lequel on décèle quelques tonalités rappelant les romans de John Steinbeck.
Au volant de sa voiture, Luce Lemay prend la fuite après le minable braquage d’un magasin de spiritueux. Dans le crépuscule, il fonce sur la Harpie Road et ne voit pas cette femme qui traverse la route avec son landau qu’il renverse. Le bébé qui s’y trouvait décède sur le coup. Après trois ans de prison, Luce est de retour à La Harpie où l’attend Junior Breen qui vient de purger une peine de 25 ans. Même si leurs nuits sont peuplées de cauchemars, nos deux compères tentent de jouer profil bas en travaillant dans une station service afin de rester dans le droit chemin. Mais quand Luce tombe éperdument amoureux de la belle Charlène, les passions se déchaînent avec une cohorte de ressentiments exacerbés par la découverte du passé criminel de Junior. Au-delà de l’atrocité du crime, a-t-on droit à une seconde chance ?
C’est au travers d’un texte sobre, aux phrases courtes dépouillées de toutes fioritures que Joe Mendo aborde avec efficacité les thèmes de la réinsertion et de la rédemption en accompagnant le destin de Luce Lemay et de Junior Breen, ce duo d’anciens prisonniers aspirant à une vie normale qui rappelle forcément la paire de trimardeurs que formait Lenny et Georges dans Des Souris et des Hommes. Paradoxalement, Luce fait preuve de davatange de naïveté que Junior, ce colosse ravagé par la culpabilité d’une crime odieux, en estimant avoir payé sa dette à la société et pouvoir ainsi refaire sa vie dans sa ville natale, lieu de la tragédie qui l’a envoyé en prison. Il s’enferme ainsi dans cette certitude du bon droit retrouvé, même si le remord le cueille régulièrement au cœur de la nuit où il distille ses cauchemards dans cette sinistre pension de famille tenue par une vieille folle qui n’a pas supporté la perte de son mari qui s’est suicidé après avoir assassiné l’amant de cette épouse volage. Junior Breen, lui ne souhaite que se plonger dans l’anonymat de cette petite petite ville provinciale en espérant pouvoir surmonter la douleur d’une faute qu’il ne pourra sans doute jamais oublier. Tout comme Luce, c’est également durant la nuit que le poids de la faute s’instille dans l’inconscience de ses pensées qui l’empêchent de trouver le sommeil. Le quotidien de ces deux personnage est fait d’instants joyeux et de phases plus sombres alors qu’ils travaillent dans une station service tenue par un ancien prisonnier qui les a pris sous son aile.
Outre le remord et la rédemption, il est beacoup question d’amour dans Le Blues de La Harpie avec cette relation passionnelle entre Luce Lemay et la belle Charlène, la jeune serveuse du diners de la ville mais également avec ces petits poèmes sybillins que Junior affiche sur le panneau de promotion de la station service et qui sont peut-être adressé à la mystérieuse jeune femme sur la photographie qu’il conserve précieusement :
« Méga promo sur tous les pneus d’occasion
clairs et ronds comme des yeux envoutés
où coule l’amour telle la sève. »
On le voit, Joe Meno distille tout au long de ce roman une atmosphère étrange et décalée qui prend parfois des tournures poétiques, quelquefois comiques, mais qui tendent résolument vers un climat inquiétant et sinistre à l’image de cet enterrement de la tante de Charlène dont le corps exposé sur son lit de mort abrite toute une cohorte de petits animaux qui y ont trouvé refuge. C’est sur cette configuration originale que l’auteur nous entraîne dans une spirale où la violence devient de plus en plus pregnante pour trouver son paroxysme dans une confrontation presque surréaliste avec les citoyens hostiles d’une ville qui paraît de plus en plus insolite. Dissimulés derrière les phares des véhicules qui pourchassent Luce et Junior, les silhouettes deviennent presque surnaturelles pour former une entité désincarnée qui semble vouée à leur perte.
Avec des personnage baroques et émouvants Le Blues de La Harpie est peuplé d’individus dont la fuite en avant éperdue devient presque onirique pour saisir le lecteur à la lisière du désespoir et de la folie. L’étrangeté poétique d’un roman qui résonne furieusement dans les confins de la noirceur. A lire sans détour.
Joe Meno : Le Blues De La Harpie (How The Hula Girl Sings). Editions Agullo 2016. Traduit de l’anglais (USA) par Morgane Saysana.
A lire en écoutant : I Walk The Line de Johnny Cash. Album : At Saint Quentin (Live). Columbia 1968.