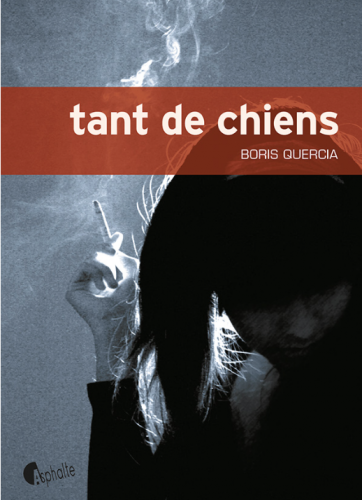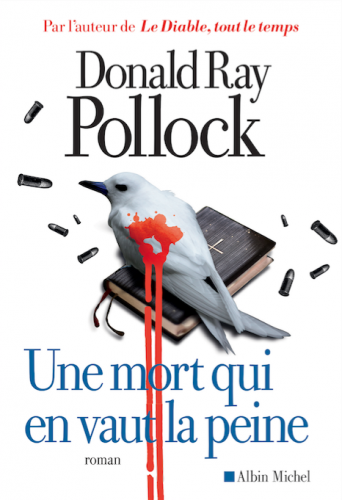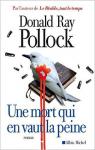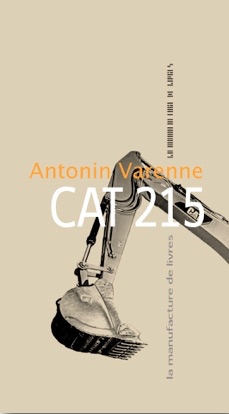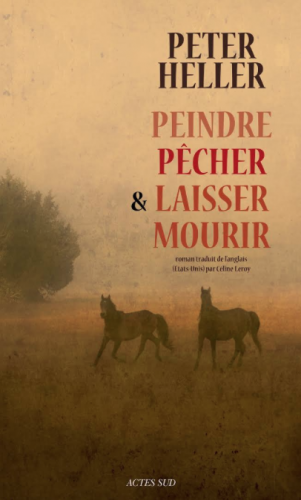Hervé Le Corre : Du Sable Dans la Bouche. Le sacre du désespoir.
 La mort dans l’âme, il faut parfois savoir renoncer à s’inscrire dans le courant enthousiaste des chroniqueurs encensant un roman comme Après la Guerre d’Hervé Le Corre. Car dans cette déferlante de louanges unanimes que pourrait-on ajouter de plus qui n’a pas été dit ? Alors, après deux ans de silence, il ne reste peut-être plus qu’à exprimer simplement son impatience à l’idée de retrouver cet auteur majeur du polar français. Aussi, pour nous faire patienter, Rivages/Noir a choisi de publier Du Sable Dans la Bouche, dans une nouvelle édition entièrement révisée pour ce roman paru en 1993 chez Gallimard pour la collection Série Noire (n° 2327).
La mort dans l’âme, il faut parfois savoir renoncer à s’inscrire dans le courant enthousiaste des chroniqueurs encensant un roman comme Après la Guerre d’Hervé Le Corre. Car dans cette déferlante de louanges unanimes que pourrait-on ajouter de plus qui n’a pas été dit ? Alors, après deux ans de silence, il ne reste peut-être plus qu’à exprimer simplement son impatience à l’idée de retrouver cet auteur majeur du polar français. Aussi, pour nous faire patienter, Rivages/Noir a choisi de publier Du Sable Dans la Bouche, dans une nouvelle édition entièrement révisée pour ce roman paru en 1993 chez Gallimard pour la collection Série Noire (n° 2327).
Mathilde marche dans les rues de Bordeaux. Elle est sortie de prison et elle boite. Elle laisse derrière elle les quelques amis qui n’osent évoquer le drame d’autrefois. Difficile de réveiller les vieux souvenirs enfouis. Ce groupuscule d’autonomistes basques traqués par un tueur psychopathe à la solde des services secrets espagnols. Est-ce au nom d’un amour de jeunesse ou de ses anciennes convictions que Pierre s’est mis en tête d’aider les membres de cette cellule terroriste. Un démarche dangereuse, d’autant plus que les flics français ont mis en place un traquenard machiavélique pour appréhender les fugitifs. Mathilde marche dans les rues de Bordeaux. Elle est sortie de prison et elle boite. Mais la démarche est assurée car elle a fait l’acquisition d’un fusil. Il est des meurtrissures plus profondes dont on ne saurait guérir.
L’essouflement des convictions, la résignation et le sursaut dont l’ensemble est imprégné d’une logique de vengeance tels sont les thèmes qu’Hervé Le Corre aborde avec une habilité narrative singulière où, par exemple, la conjugaison des temps désigne les différentes périodes de l’histoire permettant ainsi de se dispenser de dates ou autres notions temporelles. Car finalement c’est en cela que l’auteur se distingue, avec quelques autres, dans cette maîtrise de la langue qu’il manipule avec un talent indéniable pour servir un récit à la fois poétique et implacable.
A bien des égards, Du Sable Dans la Bouche contient de nombreux éléments qui composeront la trame d’Après la Guerre. Outre l’inexorable parcours de représailles, on retrouvera des thématiques qui accompagnent toute l’œuvre de l’auteur à l’instar de ces femmes vulnérables devenant les victimes expiatrices de bourreaux manipulateurs. Dans Du Sable Dans la Bouche, Mathilde incarne donc ce personnage à la fois déterminé et fragile, en rupture total qui va demander réparation. L’enjeu du roman consiste à déterminer les raisons qui poussent la jeune femme à s’engager sur cette voie de la violence en entraînant le lecteur dans une longue analepse mettant en scène des protagonistes inquiétants comme Angel Matanzas, tueur froid et déterminé, prenant un plaisir sadique à malmener ses victimes avant de leur ôter la vie. Mais plus retords et finalement plus monstrueux il y a ces flics ambitieux n’hésitant pas à manipuler et sacrifier des vies sur l’autel de la raison d’état pour mettre en place une opération visant à interpeller un groupe d’indépendantistes basques.
Avec ce récit dense et ramassé Hervé Le Corre ne s’attarde pas vraiment sur le contexte du combat lié au nationalisme basque pour se concentrer principalement sur les protagonistes et leurs divers degrés d’implication dans cette lutte armée. Ayant choisis plus ou moins sciemment de s’engager dans le conflit on assiste au rapprochement entre Emilia la combattante déterminée et Pierre l’ancien syndicaliste qui renoue avec des convictions qu’il avait mises de côté depuis bien des années. Sympathie pour la cause ou reliquat d’un amour défunt, les motifs de Pierre sont incertains mais mettront en péril le couple qu’il vient de former avec sa compagne Mathilde qui est totalement étrangère au conflit basque. Impliquée malgré elle, la jeune femme subira les affres de cette guerre sans nom dans une inéluctable spirale de violence.
L’ambiance est triste et froide, à l’image du contexte hivernal dans lequel évoluent les différents protagonistes. Dans cette ville de Bordeaux, ainsi que dans les campagnes landaises transies on s’imprègne d’une atmosphère pesante et désenchantée qui alimente toute la noirceur d’un récit cruel où la barbarie et la compromission ne laisse aucune place à un quelconque perspective de probité et d’intégrité.
Un récit solide, une intrigue forte, Du Sable Dans la Bouche décline toute la nébulosité d’une implication belliqueuse dont les conséquences mettront à mal tous les principes de victimes qui deviennent forcément bourreaux. Un texte lumineux servant la noirceur d’un roman au souffle désespéré.
Hervé Le Corre : Du Sable Dans la Bouche. Edition Rivages/Noir 2016.
A lire en écoutant : La Ville S’endormait de Jacques Brel. Album : Les Marquises. Barclay 1977.