BENJAMIN WHITMER : CRY FATHER. BORN IN THE USA.
« Je vis en Amérique et en Amérique on est tout seul. L’Amérique, c’est pas un pays, c’est que du business. Alors maintenant putain payez moi ! »
Cogan - Killing Them Softly
Film réalisé par Andrew Dominik
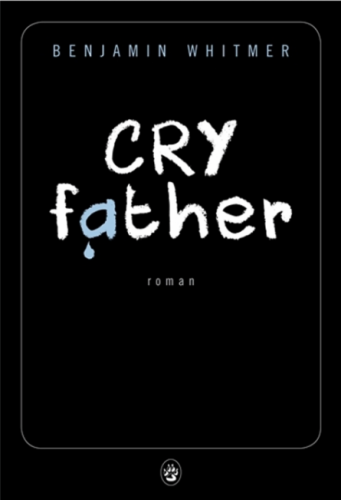 Lorsque Pike de Benjamin Whitmer est publié en 2012, il fait carrément figure d’intrus dans la ligne éditoriale de la maison d’édition Gallmeister essentiellement tournée vers le roman noir de type nature writing. Et on ne peut pas dire que les aventures d’un ancien truand réglant ses comptes dans les rues de Cincinatti entraient dans ses critères. Mais j’imagine qu’en détenant un texte pareil, on ne pouvait décemment pas orienter l’auteur vers une autre maison d’édition. Pike c’est le genre de livre qu’un éditeur, un tant soit peu lucide, ne peut pas laisser filer entre ses mains. Finalement Oliver Gallmeister a contourné le problème en créant, cette année, une nouvelle collection Néo Noir dans laquelle figure Pike, ainsi que le dernier roman de l’auteur, intitulé Cry Father.
Lorsque Pike de Benjamin Whitmer est publié en 2012, il fait carrément figure d’intrus dans la ligne éditoriale de la maison d’édition Gallmeister essentiellement tournée vers le roman noir de type nature writing. Et on ne peut pas dire que les aventures d’un ancien truand réglant ses comptes dans les rues de Cincinatti entraient dans ses critères. Mais j’imagine qu’en détenant un texte pareil, on ne pouvait décemment pas orienter l’auteur vers une autre maison d’édition. Pike c’est le genre de livre qu’un éditeur, un tant soit peu lucide, ne peut pas laisser filer entre ses mains. Finalement Oliver Gallmeister a contourné le problème en créant, cette année, une nouvelle collection Néo Noir dans laquelle figure Pike, ainsi que le dernier roman de l’auteur, intitulé Cry Father.
On ne peut pas dire que Patterson Wells soit un homme stable et fiable. Mais depuis qu’il a perdu son fils, l’homme parcours le pays pour travailler en tant qu’élagueur sur les zones sinistrées des USA en déblayant les décombres. Entre deux chantiers, Patterson retourne du côté Denver où il cultive son mal être à coup de bitures et de souvenirs dans une cabane isolée de la San Luis Valley. Tout pourrait être simple, s’il n’y avait pas le fils de son voisin et meilleur ami Henry qui débarque dans la région. Outre le fait d’être dealer, Junior a une sérieuse tendance à s’attirer des problèmes en provoquant des bagarres aussi brutales que sanglantes. Désormais liés par une amitié complexe, le deux hommes vont s’entraîner l’un l’autre dans une spirale d’ennuis meurtriers.
Ce qu’il y a de surprenant avec les romans de Benjamin Whitmer, c’est cette espèce de spontanéité qui émane d’une écriture aussi fluide que percutante. Whitmer n’écrit pas, il respire en inspirant des mots et en expirant des phrases qui s’enchaînent les unes aux autres pour former un texte d’une cinglante perfection. Il faut bien l’admettre, l’auteur détient cette faculté peu commune de conjuguer la simplicité avec le génie, comme si tout cela coulait de source. Cette aisance innée dans l’écriture permet au lecteur de lire les romans de Benjamin Whithmer d’une traite, ce qui équivaut presque à un regret lorsque l’on achève un tel ouvrage aussi rapidement.


Cry Father, tout comme Pike, aborde les problèmes d’une paternité perdue au cœur de cette Amérique en marge. Que ce soit Pike, Patterson, Henry ou Junior, ces hommes doivent faire face soit à leurs défaillances en tant que père soit à la disparition d’un fils ou d’une fille. Les démarches pour se reconstituer sont bien évidemment chaotiques et toutes empruntes d’une maladresse crasse qui font que la possibilité d’une quelconque rédemption se résume à une lointaine illusion. Dans Cry Father, l’auteur délaisse l’aspect noir de l’intrigue pour explorer de manière plus approfondie ce thème de prédilection. Cela se traduit par les messages poignants que Patterson adresse à son fils défunt pour décrire la vacuité de sa vie actuelle. C’est ainsi que sur une poignée de pages l’auteur parvient à décrire la situation dramatique de la Nouvelle Orléans, après l’ouragan Katerina et la raison pour laquelle son personnage principal est désormais toujours armé.
Toujours dans cette même veine spontanée, le récit s’enchaine dans une succession de scènes dans lesquelles évoluent des personnages hauts en couleur qui se laissent porter par leur destinée. Il y a tout au long de l’histoire cette tension permanente enrobée d’une indolence trompeuse troublée soudainement par des éclats d’une violence aussi brutale que saisissante.
Benjamin Whitmer décrit donc une Amérique chaotique qu’il se garde bien de critiquer. Natif de l’Ohio, il nous livre un point de vue de l’intérieur où il donne la parole à cette majorité silencieuse qui n’est plus représentée. Au travers du regard de l’auteur, le lecteur s’immerge au cœur d’un pays rude emprunt d’une certaine désillusion. Une vision pessimiste et apocalyptique relayée, entre autre, par les diatribes de l’animateur radio Brother Joe qui balance sur les ondes les versions paranoïaques des nouvelles du monde. Outre des personnages rugueux, cabossées par la vie, Benjamin Whitmer dépeint avec acuité les banlieues sauvages des villes industrielles sur le déclin. On y perçoit les effluves acides des polluants et les odeurs écœurantes de la charogne qui imprègnent ces zones d’habitations décaties transpercées de longues langues de bitumes rectilignes.
On est donc bien loin du bien-pensant et du politiquement correct. Cry Father c’est la description d’un univers troublant et dérangeant qui fascinera les lecteurs les plus blasés. C’est la marque de fabrique sans ambages de Benjamin Whitmer.
Benjamin Whitmer : Cry Father. Editions Gallmeister/Néo Noir 2015. Traduit de l’anglais (USA) par Jacques Mailhos.
A lire en écoutant : Love is Battlefield de Raining Jane. Album : The Good Match. Raining Jane 2011.
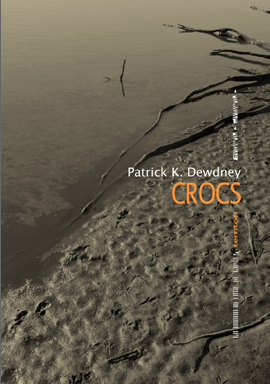 Cyril Herry et Pierre Fourniaud. Retenez bien ces deux noms car ces éditeurs possèdent le rare talent de concentrer dans leur nouvelle collection Territori, issue des éditions Ecorce et de la Manufacture de Livres, une palette d’auteurs exceptionnels comme Séverine Chevalier avec Clouer l’Ouest, ou Frank Bouysse avec Grossir le Ciel. Désormais il faut également compter avec Crocs de Patrick K Dewdney. Bien plus qu’un simple courant de type Nature Writing, Territori s’inscrit dans une volonté de mettre en lumière un artisanat de l’écriture finement ciselée d’où émane des textes d’une singulière puissance.
Cyril Herry et Pierre Fourniaud. Retenez bien ces deux noms car ces éditeurs possèdent le rare talent de concentrer dans leur nouvelle collection Territori, issue des éditions Ecorce et de la Manufacture de Livres, une palette d’auteurs exceptionnels comme Séverine Chevalier avec Clouer l’Ouest, ou Frank Bouysse avec Grossir le Ciel. Désormais il faut également compter avec Crocs de Patrick K Dewdney. Bien plus qu’un simple courant de type Nature Writing, Territori s’inscrit dans une volonté de mettre en lumière un artisanat de l’écriture finement ciselée d’où émane des textes d’une singulière puissance.
 Depuis que j’anime ce blog, je me permets de n’accepter que très rarement des services de presse pour des maisons d’éditions, ce qui réduit quelque peu la possibilité de m’infliger des lectures insipides, voir même désagréables. Mais il y a parfois derrière cette démarche une véritable volonté de défendre un auteur et de faire en sorte que l’ouvrage publié bénéficie d’un écho plus conséquent. Une démarche d’autant plus louable pour des petites maisons d’éditions qui prennent de véritables risques en publiant des écrivains qui ne bénéficient pas toujours de la visibilité qu’ils seraient pourtant en droit de mériter. L’un des avantages du service de presse c’est de découvrir des romans que l’on n'aurait, à priori, pas sélectionner en musardant dans les librairies. Je pense que cela aurait été le cas avec le dernier ouvrage de Joseph Incardona, Derrière les Panneaux il y a des Hommes. Et ça aurait été bien dommage.
Depuis que j’anime ce blog, je me permets de n’accepter que très rarement des services de presse pour des maisons d’éditions, ce qui réduit quelque peu la possibilité de m’infliger des lectures insipides, voir même désagréables. Mais il y a parfois derrière cette démarche une véritable volonté de défendre un auteur et de faire en sorte que l’ouvrage publié bénéficie d’un écho plus conséquent. Une démarche d’autant plus louable pour des petites maisons d’éditions qui prennent de véritables risques en publiant des écrivains qui ne bénéficient pas toujours de la visibilité qu’ils seraient pourtant en droit de mériter. L’un des avantages du service de presse c’est de découvrir des romans que l’on n'aurait, à priori, pas sélectionner en musardant dans les librairies. Je pense que cela aurait été le cas avec le dernier ouvrage de Joseph Incardona, Derrière les Panneaux il y a des Hommes. Et ça aurait été bien dommage.