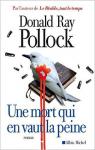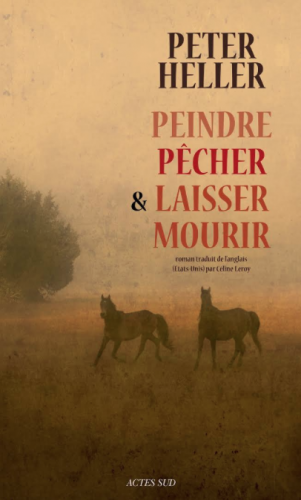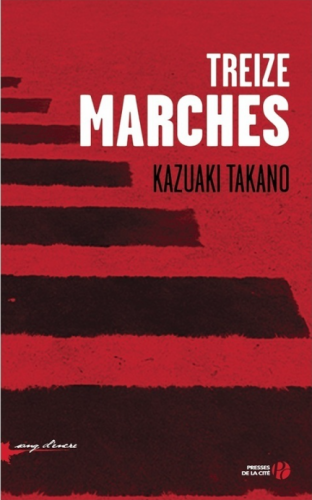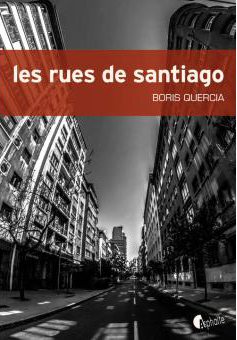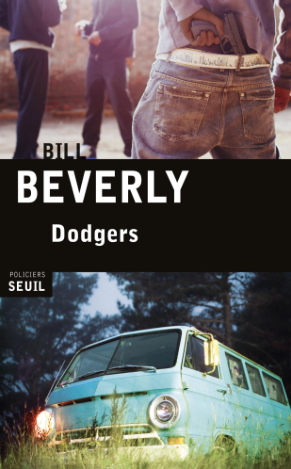Donald Ray Pollock : Une Mort Qui en Vaut la Peine. La part d’ombre.
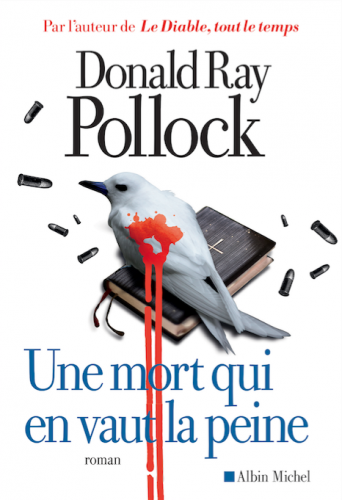 Service de presse
Service de presse
L’Homme pour l’essentiel est ce qu’il cache : un misérable petit tas de secrets. C’est probablement avec cette citation d’André Malraux que l’on peut appréhender toute la noirceur de l’œuvre de Donald Ray Pollock qui nous avait ébloui avec Le Diable, Tout le Temps, un roman ténébreux démystifiant sauvagement la période faste des années quarante aux années soixante, incarnée par ce fameux rêve américain. Troisième roman de l’auteur, Une Mort Qui en Vaut la Peine poursuit cette sombre exploration de l’âme humaine en nous proposant de suivre le destin des frères Jewett, braqueurs de banque néophytes, sévissant durant l’année 1917 entre les états de l’Alabama et de l’Ohio.
En 1917, dans un coin paumé situé entre la Georgie et L’Alabama, les frères Jewett s’échinent à la tâche comme ouvriers agricoles, sous la férule d’un père mystique. Une vie de misère qui trouvera sa récompense au paradis, lors du festin céleste comme le certifie ce vieillard qui perd peu à peu la raison. Mais à sa mort, les trois frères décident de poursuivre un autre rêve inspiré d’un roman populaire mettant en scène un bandit de grand chemin. Chevauchant leurs montures, ils écument les banques de la région avec une audace surprenante tout en bénéficiant d’une chance insolente. Dès lors, une horde de poursuivants se lancent à leurs trousses pour bénéficier de la récompense qui devient de plus en plus conséquente, à la mesure de leurs retentissants exploits.
Même si les événements se déroulent en 1917, on est bien loin de la fresque historique puisque Donald Ray Pollock se détourne des personnages célèbres pour mettre en scène une kyrielle de protagonistes anonymes qu’il dépeint dans des portraits féroces, dépourvus de la moindre complaisance. Néanmoins, pour s’immerger dans le contexte de l’époque, on perçoit, comme des échos lointains, le fracas de cette guerre qui ravage l’Europe et l’émergence des chaînes de montage de Détroit, illustrant les débuts d’une ère nouvelle d’industrialisation. Mais bien loin de tous ces progrès, les frères Jewett vont s’illustrer dans des braquages brutaux et parfois sanglants qui font référence à ce temps révolu des westerns tandis que le couple Fiddler, privé de leur fils indigne, s’acharne à remettre en selle leur petite exploitation agricole après avoir été spolié par un escroc qui s’est emparé de toutes leurs économies. On suit donc ces parcours parallèles en se demandant tout au long du récit comment ces deux destinées si dissemblables peuvent être amenées à se croiser. C’est l’un des enjeux du roman où Donald Ray Pollock mets en scène une impressionnante succession de personnages dont les caractéristiques se dévoilent au rythme d’anecdotes croustillantes, parfois cocasses et très souvent terrifiantes révélant toute les failles, perversions et dépravations des acteurs du roman.
Avec Une Mort Qui en Vaut la Peine, une grande partie du récit se déroule en dehors de l’Ohio. Mais on retrouve tout de même le comté de Ross, où l’auteur à l’habitude de camper toutes ses histoires. On découvre ainsi le Camp Sherman, centre de recrutement situé à proximité de la ville de Meade (Chillicothe) où les soldats côtoient la population au cœur d’une espèce de cloaque grouillant dans lequel se débattent tous les personnages du récit. Une cité animée qui devient l’illustration pernicieuse d’un progrès chaotique à l’instar des toilettes que l’on installe désormais dans tous les foyers et dont Jasper, inspecteur de l’hygiène publique, doit contrôler le niveau, les deux pieds plantés ainsi, au propre comme au figuré, dans la fange de l’humanité. Paradoxalement il s’agit du personnage le plus lumineux du roman avec le jeune Cob Jewett car du barman sociopathe au lieutenant homosexuel fantasmant sur ses recrues, du banquier véreux au shérif corrompu, des prostituées fanées aux artistes licencieux, il y a dans ce roman des personnages qui s’acceptent dans le mal qu’ils incarnent ou qui tentent, souvent en vain, de rejeter les travers de leurs personnalités. Parce qu’il opère par petites touches au travers de tous ces portraits, Donald Ray Pollock répand insidieusement le mal tout au long d’un texte extrêmement riche en péripétie nous permettant de digérer ce roman aussi dense qu’intense et dont le titre évoque les thématiques du sacrifice et du renoncement. Ainsi, au-delà de l’abjection, au-delà du mal, on distingue une lueur d’espoir dans un épilogue aussi poignant que bouleversant.
Sobre quand c’est nécessaire, lyrique quand il le faut, Une Mort Qui en Vaut la Peine est un bel équilibre de noirceur et d’espérance confirmant la propension d’un auteur à mettre en scène, sans fard, sans fioriture et avec un talent qui semble presque inné, toutes les fêlures désagrégeant la conscience de chacun des protagonistes de ce roman crépusculaire.
Donald Ray Pollock : Une Mort Qui en Vaut la Peine (The Heavenly Table). Editions Albin Michel/Terres d’Amérique à paraître le 3 octobre 2016. Traduit de l’anglais par Bruno Boudard.
A lire en écoutant : In the Garden de Van Morisson. Album : No Guru, No Method, No Teatcher. The Exil productions Ltd 1986.