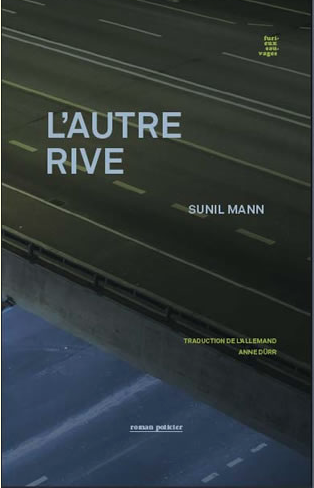WILLIAM MCILVANNEY : LAIDLAW. LE SENS DE LA MISSION.
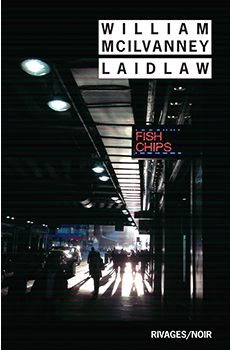 Les éditions Rivages poursuivent leur magnifique travail de réédition en s’attaquant cette fois-ci à l’œuvre de William McIlvanney, considéré, à juste titre, comme l’un de grands auteurs du roman noir écossais. Il s’agissait de remettre au goût du jour un romancier injustement oublié auquel pourtant bon nombre d’écrivains comme Ian Rankin ou Val MacDermid rendent régulièrement hommage. C’est avec Docherty, roman social sur les mineurs de Glascow, que William McIlvanney débute sa carrière, avant d’entamer une quatuor de romans noirs mettant en scène l’inspecteur Jack Laidlaw. Il sied de prêter une attention soutenue en ce qui concerne l’ordre de la quadrilogie qui débute avec le roman éponyme Laidlaw, suivi de Les Papiers de Tony Veich et qui s’achève avec Big Man et Etranges Loyautés. Voilà pour les recommandations.
Les éditions Rivages poursuivent leur magnifique travail de réédition en s’attaquant cette fois-ci à l’œuvre de William McIlvanney, considéré, à juste titre, comme l’un de grands auteurs du roman noir écossais. Il s’agissait de remettre au goût du jour un romancier injustement oublié auquel pourtant bon nombre d’écrivains comme Ian Rankin ou Val MacDermid rendent régulièrement hommage. C’est avec Docherty, roman social sur les mineurs de Glascow, que William McIlvanney débute sa carrière, avant d’entamer une quatuor de romans noirs mettant en scène l’inspecteur Jack Laidlaw. Il sied de prêter une attention soutenue en ce qui concerne l’ordre de la quadrilogie qui débute avec le roman éponyme Laidlaw, suivi de Les Papiers de Tony Veich et qui s’achève avec Big Man et Etranges Loyautés. Voilà pour les recommandations.
Le jeune Tommy Bryson court dans les rues de Glascow, sans trop savoir où aller. Il a de quoi paniquer car il vient d’assassiner une jeune fille et ne sait plus trop vers qui se tourner. Peut-être trouvera-t-il de l’aide auprès de son amant Harry Redburn, acoquiné au milieu de la pègre. Mais la nouvelle du meurtre suscite une grande émotion et il n’y a guère de personnes compatissantes pour soutenir un assassin de cet acabit. Surtout lorsque le père de la victime souhaite faire justice lui-même et demandant le soutient du caïd de la ville qui prône la justice impitoyable de la rue. L’inspecteur Laidlaw devra donc interpeller le jeune fugitif le premier, s’il veut éviter un bain de sang. D’autant plus que ses collègues ne seraient vraiment pas contre une justice expéditive.
Datant de 1977, Laidlaw met en scène tout d’abord un Glascow qui n’existe plus avec ses grands ensembles de quartiers ouvriers et une pègre atypique essentiellement basée dans les quartiers périphériques de la ville en fonction de la confession religieuse des habitants. La conglomération protestante est dirigée d’une main de fer par John Rhodes. L’homme incarne une espèce de patriarche aussi impitoyable qu’inquiétant auprès duquel les ouvriers peuvent demander de l’aide comme le fera le père de la victime qui a toujours été incapable de développer le moindre sentiment d’affection vis à vis de sa fille. La perte de son enfant ne chagrine pas ce père désormais dépouillé de son sujet d’animosité. Pour compenser cette colère et cette dureté qu’il ne peut plus faire valoir, il devra canaliser sa haine et la diriger vers le jeune meurtrier. Le tout est de savoir si cet homme aussi dur qu’honnête parviendra à franchir le pas en devenant un meurtrier à son tour.
Pègre, policiers, meurtriers, on est pourtant bien loin avec Laidlaw du roman policier au sens classique du terme. Avec maestria William McIlvanney dresse le sombre portrait social d’une ville dont il maîtrise tous les aspects. Glascow devient une terrible scène dramatique sur laquelle l’auteur déploie une mécanique insidieuse de colère et de haine. Plutôt que de s’intéresser au meurtrier, l’auteur s’emploie à décrire le ressentiment et la détresse des gens face à un acte aussi abjecte. Il parvient à mettre en perspective ce désarroi terrible qui pousse les différents protagonistes vers leurs derniers retranchements.
Et puis il y a bien évidemment le personnage principal qui sort tout de même de l’ordinaire. Oui il y ce schéma classique du policier atypique, peu apprécié de ses collègues. Mais Jack Laidlaw est un personnage qui transcende les clichés. Il personnifie ces flics lucides et humanistes tout à la fois qui se dressent contre les a priori et les schémas simplistes de leurs collègues. Paradoxalement cela ne fait pas de Jack Laidlaw quelqu’un de meilleur, bien au contraire. Dépressif, solitaire, Jack Laidlaw est un personnage parfaitement antipathique que seul le jeune Harckness est en mesure d’apprécier, même s’il est parfois tenté de suivre les opinions tranchées et brutales de l’inspecteur Milligan. A force de cogiter et de se poser des questions sur le sens des actes criminels auxquels il est confronté, Jack Laidlaw ne fait qu’irriter sa hiérarchie et ses partenaires qui ne peuvent lui opposer que des certitudes factices, sans aucun fondement. Jack Laidlaw les renvoie à leur propre vacuité qui ne peut susciter qu’indignation et incompréhension. Pourquoi se poser des questions lorsque l’on est flic alors qu’il y a la certitude de la mission à accomplir.
"Laidlaw ne dit rien. Il était penché sur le guichet, écrivant sur son bout de papier lorsque Miligan entra, une porte de grange sur patte. Ces derniers temps il jouait les chevelus pour montrer qu’il était libéral. Cela faisait paraître sa tête grisonnante plus grande que nature, une sorte de monument public. Laidlaw se souvint qu’il ne l’aimait pas. Ces derniers temps il avait été au centre de pas mal des interrogations de Laidlaw quant à savoir ce qu’il faisait. Associé à Milligan par la force des choses, Laidlaw s’était demandé s’il était possible d’être policier sans être fasciste."
Il était temps de redécouvrir la belle écriture de William McIlvanney et même s’il date, un peu, Laidlaw reste un roman terriblement actuel qu’il vous faut lire dans les plus brefs délais.
William McIlvanney : Laidlaw. Rivages/Noir 2015. Traduit de l’anglais par Jan Dusay.
A lire en écoutant : The Last Ship de Sting. Album : The Last Ship. A&M Records 2013.
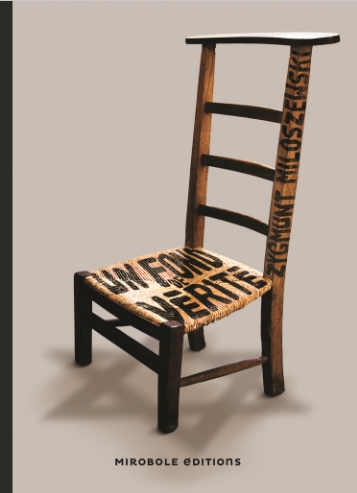
 Après avoir évoqué les aspects troubles des services secrets polonais dans Les Impliqués, Zygmunt Miloszewski aborde de manière beaucoup plus frontale toute la problématique de l’antisémitisme qui gangrène encore son pays. C’est tout d’abord au travers des constatations d’un généalogiste que l’on prend conscience de l’ampleur des pogroms qui ont décimé la population juive du pays. Avec cette première scène subtile l’auteur fait en sorte de nous immerger immédiatement dans le contexte car c’est également par l’entremise de ce personnage que nous découvrons la ville de Sandomiersz et la première victime du roman. Au delà de son décor pittoresque, Zygmunt Miloszewski réussit à intégrer la ville de Sandomierz au cœur du récit jusqu’à ce qu’elle devienne un personnage à part entière, doté de secrets peu flatteurs à l’instar de ce tableau de Charles de Prévôt mettant en scène des sacrifices de nouveaux-nés chrétiens pratiqués par les juifs pour confectionner le pain azyme. En intégrant des éléments réels, l’auteur installe une atmosphère pesante qui alimente la confusion et la paranoïa de tous les protagonistes. Et s’il y avait un fond de vérité dans ces vieilles légendes ? Le doute, comme une maladie honteuse, parvient même à faire vaciller les certitudes du procureur Szacki.
Après avoir évoqué les aspects troubles des services secrets polonais dans Les Impliqués, Zygmunt Miloszewski aborde de manière beaucoup plus frontale toute la problématique de l’antisémitisme qui gangrène encore son pays. C’est tout d’abord au travers des constatations d’un généalogiste que l’on prend conscience de l’ampleur des pogroms qui ont décimé la population juive du pays. Avec cette première scène subtile l’auteur fait en sorte de nous immerger immédiatement dans le contexte car c’est également par l’entremise de ce personnage que nous découvrons la ville de Sandomiersz et la première victime du roman. Au delà de son décor pittoresque, Zygmunt Miloszewski réussit à intégrer la ville de Sandomierz au cœur du récit jusqu’à ce qu’elle devienne un personnage à part entière, doté de secrets peu flatteurs à l’instar de ce tableau de Charles de Prévôt mettant en scène des sacrifices de nouveaux-nés chrétiens pratiqués par les juifs pour confectionner le pain azyme. En intégrant des éléments réels, l’auteur installe une atmosphère pesante qui alimente la confusion et la paranoïa de tous les protagonistes. Et s’il y avait un fond de vérité dans ces vieilles légendes ? Le doute, comme une maladie honteuse, parvient même à faire vaciller les certitudes du procureur Szacki.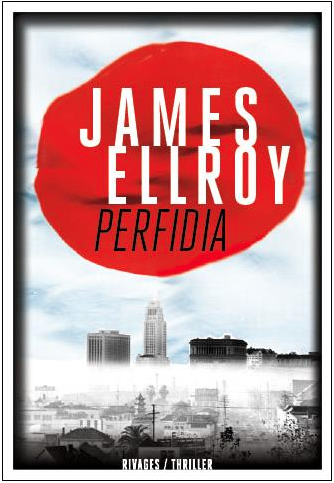
 Si Ellroy a pour habitude d’inclure dans ses romans des personnages réels, c’est la première fois qu’il met en scène l’un d’entre eux, parmi les protagonistes principaux. C’est ainsi qu’il romance la vie de William Parker, l’un des plus célèbres directeurs du LAPD dont le quartier général porte, aujourd’hui encore, son nom. Comme bon nombre de ses héros, Ellroy dresse un portrait sombre et ambivalent d’un homme d’une grande intelligence et d’une clairvoyance extrême le contraignant, presque à son corps défendant, à mettre en place de sombres machinations afin de satisfaire sa soif d’ambition que l’alcool n'arrive pas à étancher. Un personnage torturé qui ne parvient pas à s’aimer tout comme son alter égo féminin, Kay Lake.
Si Ellroy a pour habitude d’inclure dans ses romans des personnages réels, c’est la première fois qu’il met en scène l’un d’entre eux, parmi les protagonistes principaux. C’est ainsi qu’il romance la vie de William Parker, l’un des plus célèbres directeurs du LAPD dont le quartier général porte, aujourd’hui encore, son nom. Comme bon nombre de ses héros, Ellroy dresse un portrait sombre et ambivalent d’un homme d’une grande intelligence et d’une clairvoyance extrême le contraignant, presque à son corps défendant, à mettre en place de sombres machinations afin de satisfaire sa soif d’ambition que l’alcool n'arrive pas à étancher. Un personnage torturé qui ne parvient pas à s’aimer tout comme son alter égo féminin, Kay Lake.