OLIVIER CHAPUIS : LE PARC. LE PRIX DU SANG.
 Même si je ne suis pas un aficionado des rencontres avec auteurs et éditeurs en tout genre, même si je ne fréquente que très rarement les salons et autres festivals du livre, il est immanquable, au fil des années, de faire quelques agréables rencontres dans le monde littéraire à l’instar de Giuseppe Merrone, directeur de la maison d’éditions BSN Press, dont la connaissance en matière de romans noirs et policiers semble incommensurable. C’est peu dire que j’apprécie la sensibilité du personnage qui possède cette particularité, désormais presque exceptionnelle, de travailler avec les auteurs sur les textes qu’il publie au sein de cette belle maison d’édition. Alors bien sûr on pourra arguer le fait que la présente chronique est teintée d’un certain parti pris, ceci d’autant plus que l’on peut qualifier Le Parc d’Olivier Chapuis de parfaite illustration de ce que peut être un excellent roman noir helvétique.
Même si je ne suis pas un aficionado des rencontres avec auteurs et éditeurs en tout genre, même si je ne fréquente que très rarement les salons et autres festivals du livre, il est immanquable, au fil des années, de faire quelques agréables rencontres dans le monde littéraire à l’instar de Giuseppe Merrone, directeur de la maison d’éditions BSN Press, dont la connaissance en matière de romans noirs et policiers semble incommensurable. C’est peu dire que j’apprécie la sensibilité du personnage qui possède cette particularité, désormais presque exceptionnelle, de travailler avec les auteurs sur les textes qu’il publie au sein de cette belle maison d’édition. Alors bien sûr on pourra arguer le fait que la présente chronique est teintée d’un certain parti pris, ceci d’autant plus que l’on peut qualifier Le Parc d’Olivier Chapuis de parfaite illustration de ce que peut être un excellent roman noir helvétique.
Tout est si calme du côté de Lausanne. La quiétude de la neige recouvrant doucement l’étendue morose d’un parc figé par la froidure hivernale. Un homme étendu sur le côté, sa main encore accrochée à la serviette en cuir. Le sang qui se répand lentement sous sa tête. Un photographe saisissant silencieusement la scène du crime. L’art et le sang peuvent-ils avoir un prix ? « Si l’art ne possède pas le pouvoir de conjurer la mort, il peut cependant la magnifier. » Mais que s’est-il vraiment passé du côté du parc Mon-Repos ?
Lorsqu’ils sont de qualité, on dit souvent des romans très courts qu’ils génèrent un sentiment de frustration ce qui n’est pas le cas avec cet excellent texte d’Olivier Chapuis. En effet, Le Parc bénéficie d’un bel équilibre pour ce roman choral où l’auteur examine les points de vues des différents acteurs ayant pris part à ce fait divers sans pour autant s’appesantir sur une myriade de détails inutiles. Ici on va à l’essentiel et en quelques phrases bien senties, l’auteur parvient à dresser un portrait et surtout à capter une ambiance dans ce quotidien lausannois presque banal et ennuyeux. Mais le crime survient et alimente tout le récit en générant son lot de suspense avec une belle poursuite palpitante fourvoyant rapidement le lecteur qui ne peut se dépêtrer de certains à priori. Pourtant les apparences sont trompeuses et la résultante de l’intrigue s’avère des plus surprenantes. C’est la force de ce roman où Olivier Chapuis parvient à manipuler le lecteur et à le conduire là où il le souhaite en jouant avec la temporalité des multiples points de vue des personnages dont les noms titrent les différents chapitres.
Le portrait de la victime est particulièrement poignant. Ce quotidien ordinaire d’une vie bien rangée « agrémenté » de son lot de petites trahisons familiales et de regrets que le fait divers balaiera définitivement. Mais tout se détraque déjà légèrement avec ce rendez-vous reporté et cette rencontre surprenante dans une ancienne orangerie où officie un artiste peintre orientant ainsi toute une partie du récit vers une autre thématique où l’auteur nous interroge subtilement sur la définition de l’art et sur son prix. C’est finalement dans la réunion du fait divers et de l’art qu’Olivier Chapuis donnera une réponse teintée d’une certaine ironie morbide. Car le quotidien devient soudainement extraordinaire, le sang prend désormais une valeur artistique et l’art magnifie le crime tout en le rendant immortel.
Court et percutant, Le Parc d’Olivier Chapuis est un roman incisif dont le souffle mortel de cette balle perdue n’a pas encore fini de vous faire frémir. De la belle ouvrage comme on l’aime.
Olivier Chapuis : Le Parc. Editions BSN Press 2015.
A lire en écoutant : The Other Side of Town de Curtis Mayfield. Album : Soul Masters : Get Down. Warner Strategic Marketing 2004.

 Avec cet étrange enquêteur dandy, on pense bien évidemment au chevalier Dupin, personnage récurrent des contes d’Edgar Allan Poe lui-même natif de Boston, ville dans laquelle se déroule une partie du récit de Quentin Mouron. Force est de constater qu’il s’agit de références bien trop pesantes, mettant davantage en exergue cette indigence narrative à laquelle le lecteur est confronté. On se tournera dès lors vers le second opus de Quentin Mouron, L’Age de l’Héroïne où l’on retrouve pour la seconde fois notre détective privé atypique.
Avec cet étrange enquêteur dandy, on pense bien évidemment au chevalier Dupin, personnage récurrent des contes d’Edgar Allan Poe lui-même natif de Boston, ville dans laquelle se déroule une partie du récit de Quentin Mouron. Force est de constater qu’il s’agit de références bien trop pesantes, mettant davantage en exergue cette indigence narrative à laquelle le lecteur est confronté. On se tournera dès lors vers le second opus de Quentin Mouron, L’Age de l’Héroïne où l’on retrouve pour la seconde fois notre détective privé atypique.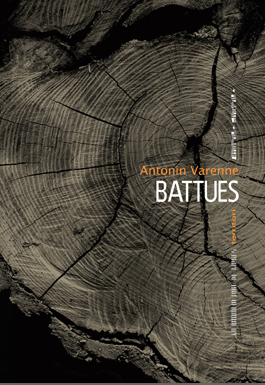
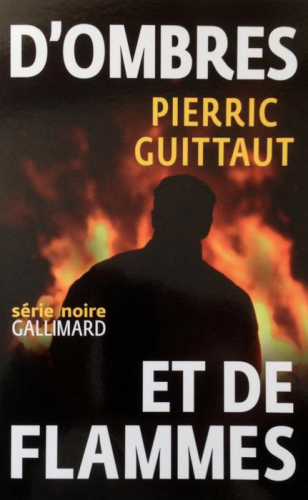
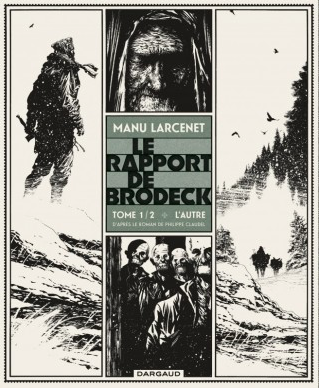
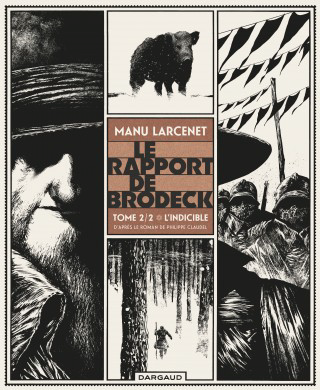 Après la quadrilogie crépusculaire de
Après la quadrilogie crépusculaire de