Friedrich Glauser : L'Inspecteur Studer. Les fondamentaux du polar suisse.
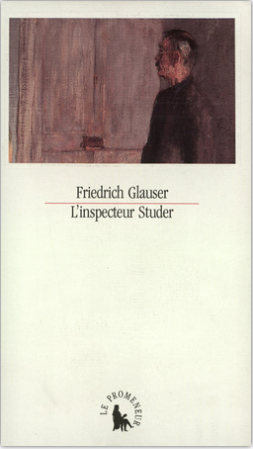 Un parcours déroutant, c’est le moins que l’on puisse dire pour qualifier la biographie de Friedrich Glauser (1896 - 1938), écrivain suisse alémanique, créateur d’une série de six romans policiers mettant en scène l’inspecteur Studer qui le rendit célèbre. Une vie familiale difficile et des fugues multiples lui vaudront des placements dans des maisons d’éducation ainsi que quelques séjours en prison. Après des études chaotiques, Friedrich Glauser travaillera comme plongeur, garçon laitier, journaliste stagiaire, mineur, horticulteur et intégrera même la Légion étrangère durant deux ans. C’est son addiction à la morphine qui le contraindra à vivre en marge de la société en effectuant de nombreux séjour en hôpital psychiatrique et en maison d’arrêt dont il s’évadera à plusieurs reprises. On retrouvera donc au travers de l’œuvre de Friedrich Glauser toute l’évocation d’une vie mouvementée qu’il conviendra de redécouvrir en mettant en perspective les scandales de placements forcés et autres internements abusifs avec une actualité récente qui a mis en lumière une page trouble et peu glorieuse de l’histoire suisse contemporaine.
Un parcours déroutant, c’est le moins que l’on puisse dire pour qualifier la biographie de Friedrich Glauser (1896 - 1938), écrivain suisse alémanique, créateur d’une série de six romans policiers mettant en scène l’inspecteur Studer qui le rendit célèbre. Une vie familiale difficile et des fugues multiples lui vaudront des placements dans des maisons d’éducation ainsi que quelques séjours en prison. Après des études chaotiques, Friedrich Glauser travaillera comme plongeur, garçon laitier, journaliste stagiaire, mineur, horticulteur et intégrera même la Légion étrangère durant deux ans. C’est son addiction à la morphine qui le contraindra à vivre en marge de la société en effectuant de nombreux séjour en hôpital psychiatrique et en maison d’arrêt dont il s’évadera à plusieurs reprises. On retrouvera donc au travers de l’œuvre de Friedrich Glauser toute l’évocation d’une vie mouvementée qu’il conviendra de redécouvrir en mettant en perspective les scandales de placements forcés et autres internements abusifs avec une actualité récente qui a mis en lumière une page trouble et peu glorieuse de l’histoire suisse contemporaine.
Esprit frondeur et indépendant, rétrogradé au rang d’inspecteur, Studer est en froid avec sa hiérarchie et fuit fréquemment son bureau de la police cantonale bernoise pour se lancer à la poursuite d’individus recherchés. C’est ainsi qu’il appréhende Schlumpf, un jeune homme un peu marginal, accusé du meurtre de son patron qui s’occupait de la réinsertion des détenus. Placé en maison d’arrêt à Thoune, le jeune homme tente de se pendre dans sa cellule et ne doit la vie sauve qu’à la prompte intervention de l’inspecteur Studer. Intrigué par les dénégations véhémentes de ce garçon perdu qui ne cesse de clamer son innocence, le policier se rend au village de Gerzenstein pour reprendre les investigations des gendarmes afin d’éclaircir les zones d’ombre d’un meurtre qui se révèle bien plus étrange qu’il n’y paraît.
Publié en 1935, L’Inspecteur Studer demeure, aujourd’hui encore, un ouvrage de référence dans le domaine du roman policier helvétique tout en restant méconnu du grand public, ce qui est fort regrettable. A l’heure, où les références du polar suisse romand se concentrent principalement sur l’aspect géographique des lieux, Friedrich Glauser dresse le décor de son premier roman dans le village fictif de Gerzenstein pour mettre en scène toute une galerie de personnages évoluant dans l’univers laborieux des classes modestes d’un pays qui, derrière une façade idyllique, révèle son lot de rivalités et de jalousies. L’auteur y évoque les difficultés d’une vie teintée d’espoirs et de déceptions dans un contexte économique qui paraît extrêmement précaire. Faillites, détournements de fonds, investissements aussi modestes qu’hasardeux, il s’en passe des choses derrières les façades de ce village tout en longueur, dont les maisons s’échelonnent de part et d’autre d’une artère unique, et il n’est donc pas étonnant qu’un meurtre finisse par s’y produire. L’inspecteur Studer devient ainsi une espèce d’anthropologue observant et décryptant tout l’aspect relationnel entre les différents protagonistes. Avec un mélange de déduction et d’intuition le policier s’immerge dans le quotidien des villageois pour mettre à jour les dissensions entre notables et villageois de conditions plus modeste.
A bien des égards, l’inspecteur Studer présente de nombreuses similitudes avec l’auteur notamment en ce qui concerne son empathie vis à vis de ces écorchés de la vie qu’il croise sur son chemin, ainsi qu’une certaine aversion paradoxale à l’autorité qui lui vaudra d’ailleurs sa rétrogradation et quelques inimitié au sein de sa hiérarchie policière. Au lieu d’opérer dans son bureau, Studer fait partie de ces policiers qui préfèrent investir les domiciles des protagonistes concernés par le meurtre ou les retrouver dans les cafés qu’ils fréquentent afin de les observer dans leurs environnements respectifs pour tenter de discerner les antagonismes pouvant constituer le mobile du crime. Toute l'intrigue du roman consiste à savoir si Schlumpf, ce jeune marginal, en voie de réinsertion, est bien coupable du crime dont il est accusé. Et avec cette scène ouvrant le roman où le jeune homme tente de se suicider dans le cachot de la maison d’arrêt de Thoune, on retrouve, là aussi, quelques éléments de la vie de Friedrich Glauser lorsque l’on apprend, en consultant sa biographie, que l’auteur fit au moins quatre tentatives pour mettre fin à ses jour, ceci dans divers établissements pénitentiaires ou psychiatriques qu’il fréquenta sa vie durant.
Parce qu’il y livre beaucoup de lui-même et de son parcours de vie, il y a de la défiance et du mordant dans l’écriture généreuse et sincère de Friedrich Glauser qui s’emploie à dépeindre sans complaisance un portrait social saisissant de réalisme dans cette atmosphère confinée, parfois lourde de tension propre à ces petits villages helvétiques si tranquilles … en apparence. Injustement méconnue, l’œuvre de Friedrich Glauser débutant avec L’Inspecteur Studer mérite d’être redécouverte toutes affaires cessantes dans le cadre de cette nouvelle effervescence du roman policier helvétique.
Friedrich Glauser : L’Inspecteur Studer (Wachtmeister Studer). Editions Gallimard/Le Promeneur 1990. Traduit de l’allemand par Catherine Clermont.
A lire en écoutant : She Rains de The Young God. Album : T .V. Sky. Play It Again Sam (PIAS) 1992.



