JIM NISBET : TRAVERSEE VENT DEBOUT. LA VERITE VRAIE.
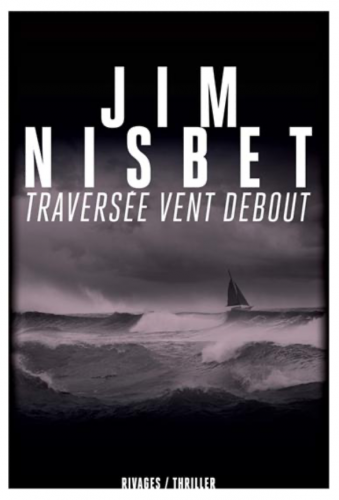 Paru en 2012, il s’agit de son dernier ouvrage publié de son vivant chez Rivages/Thriller, dans la version grand format sans qu’il n’intègre par la suite la collection Rivages/Noir qui n’aurait rien eu à envier aux pavés de James Ellroy qui saluait d’ailleurs le talent de ce romancier qui n’a jamais véritablement émerger tant son œuvre se révèle d’une singularité extrême sans pour autant être dénuée d’un humour incisif et troublant. Assurément Jim Nisbet s’inscrit dans le registre du roman noir, même s’il en a détourné les codes avec ce sentiment de liberté qui imprègne ses textes lui qui expliquait n’écrire ni pour une maison d’éditions ni pour les lecteurs qu’il n’a de cesse de bousculer tout comme ses personnages d’ailleurs. C’est pourquoi il n’est guère aisé d’aborder l’œuvre de cet écrivain avec Traversée Vent Debout, un récit dense, oscillant entre le roman d’aventure maritime et la fiction d’anticipation aux connotations obscures et qui assimile ainsi tout le parcours de vie d’un auteur ayant également exercé les métiers d’ébéniste, de charpentier et de marin et qui, natif de l’état de New York et après avoir grandi en Caroline du Nord, a toujours vécu dans la région de San Francisco qui devient le décor omniprésent de l’ensemble de son œuvre où l’on croise une myriade de marginaux et de paumés devenant les héros d’intrigues incroyables. Auteur érudit, féru de littérature française, Jim Nisbet parie donc sur l’intelligence du lecteur pour appréhender des textes d’une impressionnante profondeur à l’instar de Traversée Vent Debout désormais épuisé ce qui ne saurait constituer une excuse pour passer à côté de ce sublime et exigeant roman convoquant des références telles que Dans La Mer De Cortez (Actes sud 2009) de John Steinbeck pour son aspect maritime et Le Scarabée D’Or (Folio classique 2023) d’Edgar Allan Poe pour son côté chasse au trésor, tandis que l’on distingue en toile de fond une certaine étrangeté émergeant de cet environnement d’anticipation, de « présent visionnaire » à la James Graham Ballard. Et si vous ne parvenez pas à vous procurer l’ouvrage, vous pourrez vous rabattre sur Le Codex De Syracuse (Rivages/Noir 2025) figurant désormais parmi les 16 ouvrages iconiques que François Guérif, emblématique directeur de la maison d'éditions, a sélectionné au sein des 1152 romans que compte la collection mythique et qui a toujours défendu les romans de Jim Nisbet qu’il s’est employé à mettre en avant dans le milieu de la littérature noire francophone.
Paru en 2012, il s’agit de son dernier ouvrage publié de son vivant chez Rivages/Thriller, dans la version grand format sans qu’il n’intègre par la suite la collection Rivages/Noir qui n’aurait rien eu à envier aux pavés de James Ellroy qui saluait d’ailleurs le talent de ce romancier qui n’a jamais véritablement émerger tant son œuvre se révèle d’une singularité extrême sans pour autant être dénuée d’un humour incisif et troublant. Assurément Jim Nisbet s’inscrit dans le registre du roman noir, même s’il en a détourné les codes avec ce sentiment de liberté qui imprègne ses textes lui qui expliquait n’écrire ni pour une maison d’éditions ni pour les lecteurs qu’il n’a de cesse de bousculer tout comme ses personnages d’ailleurs. C’est pourquoi il n’est guère aisé d’aborder l’œuvre de cet écrivain avec Traversée Vent Debout, un récit dense, oscillant entre le roman d’aventure maritime et la fiction d’anticipation aux connotations obscures et qui assimile ainsi tout le parcours de vie d’un auteur ayant également exercé les métiers d’ébéniste, de charpentier et de marin et qui, natif de l’état de New York et après avoir grandi en Caroline du Nord, a toujours vécu dans la région de San Francisco qui devient le décor omniprésent de l’ensemble de son œuvre où l’on croise une myriade de marginaux et de paumés devenant les héros d’intrigues incroyables. Auteur érudit, féru de littérature française, Jim Nisbet parie donc sur l’intelligence du lecteur pour appréhender des textes d’une impressionnante profondeur à l’instar de Traversée Vent Debout désormais épuisé ce qui ne saurait constituer une excuse pour passer à côté de ce sublime et exigeant roman convoquant des références telles que Dans La Mer De Cortez (Actes sud 2009) de John Steinbeck pour son aspect maritime et Le Scarabée D’Or (Folio classique 2023) d’Edgar Allan Poe pour son côté chasse au trésor, tandis que l’on distingue en toile de fond une certaine étrangeté émergeant de cet environnement d’anticipation, de « présent visionnaire » à la James Graham Ballard. Et si vous ne parvenez pas à vous procurer l’ouvrage, vous pourrez vous rabattre sur Le Codex De Syracuse (Rivages/Noir 2025) figurant désormais parmi les 16 ouvrages iconiques que François Guérif, emblématique directeur de la maison d'éditions, a sélectionné au sein des 1152 romans que compte la collection mythique et qui a toujours défendu les romans de Jim Nisbet qu’il s’est employé à mettre en avant dans le milieu de la littérature noire francophone.
 Ce n’est jamais bon de percuter, avec son voilier le « Vellela Vellela », un container à la dérive sur la mer agitée des Caraïbes, surtout lorsque l’on transporte un kilo de cocaïne. Effectuant ce convoyage pour le compte de Red Mean, Charley Powell ne peut donc pas lancer de message de détresse avec le risque d’être incarcéré un nouvelle fois par les autorités lui portant secours. Il faut dire que ce marin accompli, au tempérament intrépide, a une soif de liberté dont il s’imprègne lors de ces escapades maritimes, mais également au gré de ses lectures et surtout dans son travail d’écriture. Et tandis que le bateau sombre dans des flots infestés de requin, il tente de sauver ce qui peut l'être, son journal de bord auquel il manque une dizaine de pages ainsi que le manuscrit d’un roman inachevé. A San Francisco, Red Mean va voir Tipsy, la sœur de Charley afin de l’informer des circonstances étranges qui entourent la disparition de son frère et lui remettre les documents qu’il a retrouvé sur les lieux du naufrage. Débute alors une étrange enquête où plus que de la cocaïne, il est question de l’ADN d’un ancien président des Etats-Unis qu’une mystérieuse organisation souhaite récupérer dans ce qui apparaît comme un complot international visant à renverser l’ordre établi.
Ce n’est jamais bon de percuter, avec son voilier le « Vellela Vellela », un container à la dérive sur la mer agitée des Caraïbes, surtout lorsque l’on transporte un kilo de cocaïne. Effectuant ce convoyage pour le compte de Red Mean, Charley Powell ne peut donc pas lancer de message de détresse avec le risque d’être incarcéré un nouvelle fois par les autorités lui portant secours. Il faut dire que ce marin accompli, au tempérament intrépide, a une soif de liberté dont il s’imprègne lors de ces escapades maritimes, mais également au gré de ses lectures et surtout dans son travail d’écriture. Et tandis que le bateau sombre dans des flots infestés de requin, il tente de sauver ce qui peut l'être, son journal de bord auquel il manque une dizaine de pages ainsi que le manuscrit d’un roman inachevé. A San Francisco, Red Mean va voir Tipsy, la sœur de Charley afin de l’informer des circonstances étranges qui entourent la disparition de son frère et lui remettre les documents qu’il a retrouvé sur les lieux du naufrage. Débute alors une étrange enquête où plus que de la cocaïne, il est question de l’ADN d’un ancien président des Etats-Unis qu’une mystérieuse organisation souhaite récupérer dans ce qui apparaît comme un complot international visant à renverser l’ordre établi.
D’entrée de jeu, il y a cet avertissement du transcripteur tel que se définit Jim Nisbet, mentionnant le fait que la lecture ne sera pas de tout repos, chose confirmée avec ce prologue aux connotations futuristes dont on ignore s’il s’agit véritablement d’une extraction des synapses neuronales d’un individu projeté au cœur d’une assemblée contemplant une transmutation confuse nous donnant l’impression d’intégrer un songe dont on peine à saisir le sens. Mais dès le premier chapitre, le récit prend une tout autre tournure avec ce naufrage de Charley Powell dont on perçoit le moindre détail, caractéristique du style d’un auteur s’employant à dépeindre chacune des manœuvres de ce marin aguerri dans ce qui apparaît comme une véritable aventure maritime dantesque imprégnée d’un vocabulaire technique en matière de navigation qui nous donne une véritable sensation d’immersion qui peut tout de même décontenancer le lecteur. C’est ce qui émerge d’ailleurs de l’ensemble du texte, où l’auteur se soucie très peu du confort de ce lecteur, sans pour autant l’abandonner dans les méandres de cette intrigue prenant également la forme d’une espèce de complot où l’enjeu du trafic de drogue s’efface au profit de cet ADN mystérieux qui va mobiliser toutes les parties prenantes cherchant à savoir ce qu’il est advenu de Charly Powell et de son étrange cargaison, à commencer par sa sœur Teresa que tout le monde surnomme Tipsy, femme séduisante quelque peu portée sur la boisson qu’elle consomme dans son bar fétiche de San Francisco en compagnie de son ami Quentin dont la relation avec son compagnon instable s’étiole, tandis qu’il lutte contre l’infection HIV qui affaiblit son organisme. Traversée Vent Debout, c’est également une mise en abime du travail d’écriture, des doutes et parfois du découragement telle qu’on le distingue au gré du parcours de Charley Powell qui a intitulé ainsi le roman qu’il n’aura pas été en mesure d'achever. Il s’agit également d’une forme d’hommage aux romanciers que Jim Nisbet affectionne que ce soit Faulkner qui devient le nom de famille de Skip, le barman où Tipsy a ses habitudes quand elle ne lit pas une quantité impressionnante d’auteurs tels que Georges Simenon, Ross McDonald, Homère également, Raymond Chandler, Dashiell Hammet, Jean-Patrick Manchette ainsi que Françoise Sagan et Georges Stendhal pour compéter ce catalogue disparate. C’est d’ailleurs ce sentiment de disparité qui émerge de ce texte exigeant, nécessitant une concentration soutenue ainsi qu’une attention au moindre pas de côté de cette intrigue échevelée nous entrainant parfois dans de longues disgressions conférant davantage d’épaisseur à l’ensemble des personnages qui traversent ce roman chaotique et détonnant. Ne respectant aucune des normes désormais en vigueur dans le monde actuel de la littérature où la moindre longueur est conspuée, Traversée Vent Debout est un roman noir audacieux comme on n’en fait plus, qui pourra certainement décourager de nombreux lecteurs mais qui récompensera les plus acharnés d’entre eux qui ne manqueront pas de ressentir le souffle de la liberté qui balaie l’intégralité d’un texte à la beauté saisissante et singulière qui vous embarque dans la "vérité vraie".
Jim Nisbet : Traversée Vent Debout (Winward Passage). Editions Rivages/Thriller 2012. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Catherine Richard & Eric Chedaille.
A lire en écoutant : Mysterons de Portishead. Album : Dummy. 1994 Go ! Discs Ltd.
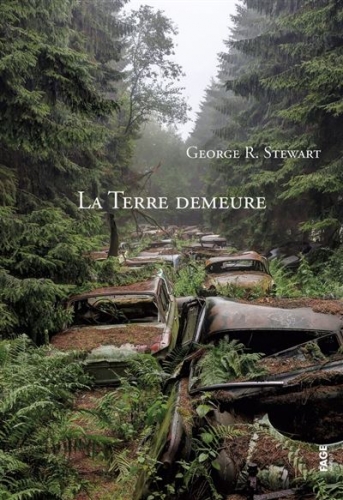
 Dans le cadre de la préparation de sa thèse, Isherwood Williams, que tout monde surnomme Ish, s’est isolé dans les hauteurs des montagnes californiennes. Mais après avoir été mordu par un serpent, il est contraint de retourner dans la cabane qu’il a louée afin d’extraire le venin de sa main déjà enflée. Désormais alité, en proie à un accès de fièvre, il reste donc cloîtré plusieurs jours avant de retourner vers la civilisation. Mais bien vite, Ish s’aperçoit qu’une maladie mystérieuse semble avoir décimé toute la population. Afin de s’en assurer, il entame une expédition en traversant l’entièreté du pays avec ce constat amer que tout s’est effondré et qu’il ne reste que quelques survivants comme lui. Avec cet effroyable constat, il retourne en Californie où il a toujours vécu, non loin du du Golden Gate Bridge qui apparaît désormais comme un monument du passé. C’est là qu’il parviendra à fonder une famille à laquelle s’agrège quelques femmes et hommes qui formeront une petite communauté qui tente de survivre tant bien que mal sur le reliquat d’un monde où il désormais nécessaire de se réinventer au rythme des aléas auxquels il faut faire face
Dans le cadre de la préparation de sa thèse, Isherwood Williams, que tout monde surnomme Ish, s’est isolé dans les hauteurs des montagnes californiennes. Mais après avoir été mordu par un serpent, il est contraint de retourner dans la cabane qu’il a louée afin d’extraire le venin de sa main déjà enflée. Désormais alité, en proie à un accès de fièvre, il reste donc cloîtré plusieurs jours avant de retourner vers la civilisation. Mais bien vite, Ish s’aperçoit qu’une maladie mystérieuse semble avoir décimé toute la population. Afin de s’en assurer, il entame une expédition en traversant l’entièreté du pays avec ce constat amer que tout s’est effondré et qu’il ne reste que quelques survivants comme lui. Avec cet effroyable constat, il retourne en Californie où il a toujours vécu, non loin du du Golden Gate Bridge qui apparaît désormais comme un monument du passé. C’est là qu’il parviendra à fonder une famille à laquelle s’agrège quelques femmes et hommes qui formeront une petite communauté qui tente de survivre tant bien que mal sur le reliquat d’un monde où il désormais nécessaire de se réinventer au rythme des aléas auxquels il faut faire face Il y a les rapports du GIEC, les travaux scientifiques, les reportages et bien évidemment l'actualité mettant en relief les implications du dérèglement climatique sans que l'on ne réalise véritablement les conséquences qui vont marquer durablement l'ensemble des nations, bien au-delà de cette notion triviale des frontières. La littérature n'est pas en reste avec bon nombre de romans s'inscrivant dans un registre apocalyptique faisant froid dans le dos illustrant ces catastrophes climatiques qui frappent déjà la plupart des pays avec une intensité de plus en plus accrue. On dit de ces ouvrages qu'ils prennent la forme d'une dystopie puisqu'ils se projettent sur une notion d'avenir où l'on s'immerge dans la chaos d'un monde désormais ravagé par les affres d'une succession de désastres aussi impitoyables qu'immuables. Le Déluge, dernier roman de Stephen Markley que l'on avait découvert avec
Il y a les rapports du GIEC, les travaux scientifiques, les reportages et bien évidemment l'actualité mettant en relief les implications du dérèglement climatique sans que l'on ne réalise véritablement les conséquences qui vont marquer durablement l'ensemble des nations, bien au-delà de cette notion triviale des frontières. La littérature n'est pas en reste avec bon nombre de romans s'inscrivant dans un registre apocalyptique faisant froid dans le dos illustrant ces catastrophes climatiques qui frappent déjà la plupart des pays avec une intensité de plus en plus accrue. On dit de ces ouvrages qu'ils prennent la forme d'une dystopie puisqu'ils se projettent sur une notion d'avenir où l'on s'immerge dans la chaos d'un monde désormais ravagé par les affres d'une succession de désastres aussi impitoyables qu'immuables. Le Déluge, dernier roman de Stephen Markley que l'on avait découvert avec 
 quête de reconnaissance. On mettra de côté ces assertions puériles, ce d'autant plus que la puissance de ce texte saisissant et épuré ne semble nullement être remis en cause par celles et ceux que le succès rebute. Il faut parler ici de saisissement, parce que, si la fureur ainsi que la sauvagerie ont toujours imprégné les récits intenses de Cormac McCarthy, La Route se distingue par la prégnance de son désespoir profond, au sein d'une humanité qui se dissout dans une violence aveugle, teintée d'une forme de mysticisme féroce. Pour celles et ceux qui l'ont lu, on connait tous le symbolisme de La Route, cette ligne de vie fragile sur laquelle chemine un père et son fils qui détiendrait un reliquat d'humanité que la figure paternelle s'emploie à entretenir tout en lui inculquant les règles impitoyables de la survie dans ce milieu hostile
quête de reconnaissance. On mettra de côté ces assertions puériles, ce d'autant plus que la puissance de ce texte saisissant et épuré ne semble nullement être remis en cause par celles et ceux que le succès rebute. Il faut parler ici de saisissement, parce que, si la fureur ainsi que la sauvagerie ont toujours imprégné les récits intenses de Cormac McCarthy, La Route se distingue par la prégnance de son désespoir profond, au sein d'une humanité qui se dissout dans une violence aveugle, teintée d'une forme de mysticisme féroce. Pour celles et ceux qui l'ont lu, on connait tous le symbolisme de La Route, cette ligne de vie fragile sur laquelle chemine un père et son fils qui détiendrait un reliquat d'humanité que la figure paternelle s'emploie à entretenir tout en lui inculquant les règles impitoyables de la survie dans ce milieu hostile  Mortensen dans le rôle principal, qui se révèle quelque peu décevante pour un film trop bavard laissant planer quelques lueurs d'espoir dont le roman est totalement dépourvu mais qui répond aux canons hollywoodiens de la famille idéale américaine. A partir de là, on pouvait réellement avoir quelques craintes avec l'annonce d'une adaptation sous la forme d'une BD par Manu Larcenet, même si le dessinateur nous a régulièrement ébloui avec des œuvres originales telles que
Mortensen dans le rôle principal, qui se révèle quelque peu décevante pour un film trop bavard laissant planer quelques lueurs d'espoir dont le roman est totalement dépourvu mais qui répond aux canons hollywoodiens de la famille idéale américaine. A partir de là, on pouvait réellement avoir quelques craintes avec l'annonce d'une adaptation sous la forme d'une BD par Manu Larcenet, même si le dessinateur nous a régulièrement ébloui avec des œuvres originales telles que  On peut le dire, l'annonce de Manu Larcenet se lançant dans cette adaptation graphique de La Route a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et constitue l'un des grands événements littéraires de cette année 2024 que l'on attendait avec une certaine fébrilité. D'ailleurs, à l'occasion de cette parution, les éditions Points ont réédité le roman dans une version collector reliée avec l'ajout d'un cordon marque-page noir tandis que le texte est agrémenté d'une vingtaine d'illustrations de Manu Larcenet. On aurait bien évidemment souhaité qu'il s'agisse d'illustrations originales plutôt qu'extraites de la bande dessinée et quitte à se montrer pénible jusqu'au bout, la couverture aurait mérité d'être toilée avec un aspect rugueux qui aurait mieux convenu. Mais quoiqu'il en soit, il faut lire ou relire le roman dans cette version pour s'approprier ainsi l'univers respectif de ces deux génies qui se rencontrent autour de ce texte imprégné de la noirceur du romancier se diluant dans celle de l'illustrateur avec cette impressionnante sensation de symbiose. Et puis il faut bien appréhender l'album en tant que tel qui se décline également sous la forme d'une édition limitée qu'il faut absolument acquérir si vous
On peut le dire, l'annonce de Manu Larcenet se lançant dans cette adaptation graphique de La Route a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et constitue l'un des grands événements littéraires de cette année 2024 que l'on attendait avec une certaine fébrilité. D'ailleurs, à l'occasion de cette parution, les éditions Points ont réédité le roman dans une version collector reliée avec l'ajout d'un cordon marque-page noir tandis que le texte est agrémenté d'une vingtaine d'illustrations de Manu Larcenet. On aurait bien évidemment souhaité qu'il s'agisse d'illustrations originales plutôt qu'extraites de la bande dessinée et quitte à se montrer pénible jusqu'au bout, la couverture aurait mérité d'être toilée avec un aspect rugueux qui aurait mieux convenu. Mais quoiqu'il en soit, il faut lire ou relire le roman dans cette version pour s'approprier ainsi l'univers respectif de ces deux génies qui se rencontrent autour de ce texte imprégné de la noirceur du romancier se diluant dans celle de l'illustrateur avec cette impressionnante sensation de symbiose. Et puis il faut bien appréhender l'album en tant que tel qui se décline également sous la forme d'une édition limitée qu'il faut absolument acquérir si vous êtes en fond. En noir et blanc, cette version contient un cahier où figure des croquis ainsi que quelques planches qui n'ont pas été retenues dans l'édition définitive. Toujours dans ce tirage limité, on appréciera les gros plans du profil du père et du fils figurant sur la couverture et sur le dos de cet ouvrage somptueux et dont la minutie dans chaque trait nous rappellent les gravures de Gustave Doré ou d'Albrecht Dürer auxquels Manu Larcenet fait d'ailleurs référence, même si l'on pense également, dans une certaine mesure, aux illustrations de Bernie Wrightson. On fera donc l'acquisition des deux albums, mais s'ił faut choisir, on adoptera la version en couleur avec cette spectaculaire nuance de gris absorbant les quelques lueurs rougeâtres ou jaunâtre parfois bleuâtres éclairant certaines planches en offrant ainsi plus de profondeur à l'ensemble du récit et plus d'intensité dramatique sur quelques scènes clés de l'intrigue comme cet instant où le père et son fils observent cette colonne de barbares défilant sur La Route. Comme une espèce de lever et de tomber de rideau ponctuant le début et la fin d'un spectacle aux accents dramatiques, il y a cette espèce d'abstraction fascinante dans la contemplation de ces nuages de cendre qui vont d'ailleurs nous accompagner tout au long de 156 planches composant l'album restituant avec une rigueur incroyable l'ensemble de la trame narrative du roman de Cormac McCarthy qui font que le monde de l'écrivain se confond avec l'univers de Manu Larcenet. Sans être expert dans le graphisme, à la contemplation de chacune des planches, de chacune des cases de La Route, on mesure la progression du dessinateur, dans sa veine réaliste depuis Blast, qui a abandonné l'encre et le papier en adoptant la palette graphique depuis quelques années, en voulant explorer
êtes en fond. En noir et blanc, cette version contient un cahier où figure des croquis ainsi que quelques planches qui n'ont pas été retenues dans l'édition définitive. Toujours dans ce tirage limité, on appréciera les gros plans du profil du père et du fils figurant sur la couverture et sur le dos de cet ouvrage somptueux et dont la minutie dans chaque trait nous rappellent les gravures de Gustave Doré ou d'Albrecht Dürer auxquels Manu Larcenet fait d'ailleurs référence, même si l'on pense également, dans une certaine mesure, aux illustrations de Bernie Wrightson. On fera donc l'acquisition des deux albums, mais s'ił faut choisir, on adoptera la version en couleur avec cette spectaculaire nuance de gris absorbant les quelques lueurs rougeâtres ou jaunâtre parfois bleuâtres éclairant certaines planches en offrant ainsi plus de profondeur à l'ensemble du récit et plus d'intensité dramatique sur quelques scènes clés de l'intrigue comme cet instant où le père et son fils observent cette colonne de barbares défilant sur La Route. Comme une espèce de lever et de tomber de rideau ponctuant le début et la fin d'un spectacle aux accents dramatiques, il y a cette espèce d'abstraction fascinante dans la contemplation de ces nuages de cendre qui vont d'ailleurs nous accompagner tout au long de 156 planches composant l'album restituant avec une rigueur incroyable l'ensemble de la trame narrative du roman de Cormac McCarthy qui font que le monde de l'écrivain se confond avec l'univers de Manu Larcenet. Sans être expert dans le graphisme, à la contemplation de chacune des planches, de chacune des cases de La Route, on mesure la progression du dessinateur, dans sa veine réaliste depuis Blast, qui a abandonné l'encre et le papier en adoptant la palette graphique depuis quelques années, en voulant explorer  l'infinie richesse de cette technologie numérique, pour un rendu plus précis dans le trait tout en devinant le travail considérable et cette créativité sous jacente qui émane de son oeuvre. Ce qui ne change pas, c'est le désespoir, la douleur et les tourments dont le dessinateur ne fait pas mystère et qui imprègnent son travail au gré de cette adaptation où rien ne nous est épargné comme cette scène où le père apprend à son fils comment mettre fin à ses jours avec le revolver qu'ils détiennent ou ce festin macabre qu'ils découvrent dans un campement abandonné. On appréciera également le soin apporté aux dialogues qui se déclinent dans une proportion congrue, comme dans le roman d'ailleurs, en nous laissant de longues plages de silence où l'on contemple l'immensité terrible de la désolation des lieux qui absorbent les personnages. Et puis au milieu de cette noirceur, il y a quelques instants lumineux comme cette baignade au pied de la cascade où la maigreur des corps nous renvoie à une autre époque de barbarie des camps de concentration tandis que le festin que le fils et le père dégustent dans un bunker inutilisé, nous rappelle cet instant de grâce dans le film Soleil Vert où Charlton Eston et Edward G. Robinson se délectent de quelques aliments frais devenus introuvables. Tout cela s'inscrit dans cette volonté exigeante de transcender le récit de Cormac Mccarthy dans ce qu'il y a de plus désespérant pour nous plonger dans un nihilisme absolu en nous laissant sur le bord de La Route au terme d'une scène finale encore plus incertaine que celle du romancier et qui font de l'adaptation de Manu Larcenet une oeuvre aussi magistrale qu'éprouvante. C'est peut-être l'une des définitions du terme chef-d’oeuvre.
l'infinie richesse de cette technologie numérique, pour un rendu plus précis dans le trait tout en devinant le travail considérable et cette créativité sous jacente qui émane de son oeuvre. Ce qui ne change pas, c'est le désespoir, la douleur et les tourments dont le dessinateur ne fait pas mystère et qui imprègnent son travail au gré de cette adaptation où rien ne nous est épargné comme cette scène où le père apprend à son fils comment mettre fin à ses jours avec le revolver qu'ils détiennent ou ce festin macabre qu'ils découvrent dans un campement abandonné. On appréciera également le soin apporté aux dialogues qui se déclinent dans une proportion congrue, comme dans le roman d'ailleurs, en nous laissant de longues plages de silence où l'on contemple l'immensité terrible de la désolation des lieux qui absorbent les personnages. Et puis au milieu de cette noirceur, il y a quelques instants lumineux comme cette baignade au pied de la cascade où la maigreur des corps nous renvoie à une autre époque de barbarie des camps de concentration tandis que le festin que le fils et le père dégustent dans un bunker inutilisé, nous rappelle cet instant de grâce dans le film Soleil Vert où Charlton Eston et Edward G. Robinson se délectent de quelques aliments frais devenus introuvables. Tout cela s'inscrit dans cette volonté exigeante de transcender le récit de Cormac Mccarthy dans ce qu'il y a de plus désespérant pour nous plonger dans un nihilisme absolu en nous laissant sur le bord de La Route au terme d'une scène finale encore plus incertaine que celle du romancier et qui font de l'adaptation de Manu Larcenet une oeuvre aussi magistrale qu'éprouvante. C'est peut-être l'une des définitions du terme chef-d’oeuvre.